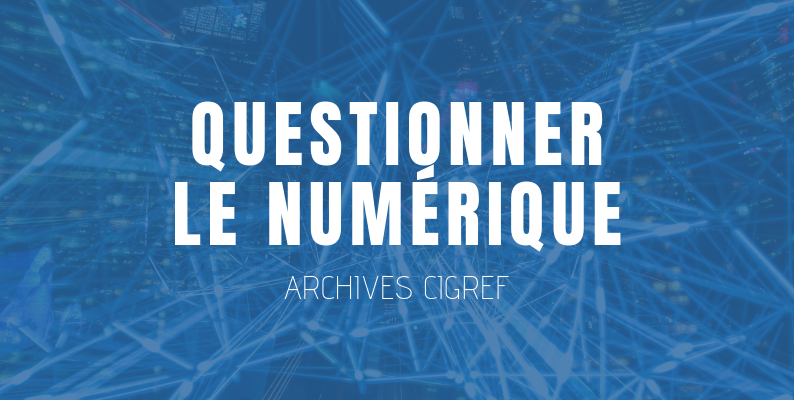L’ubérisation : est-ce un phénomène disruptif ?
Le terme « ubérisation » est un terme nouveau qui, selon nos sources, fut inventé par Maurice Lévy en décembre 2014. Mais plutôt que de nous étendre sur les aspects ontologiques, nous préférons centrer notre attention sur l’aspect phénoménologique. L’« ubérisation » caractérise une économie du partage d’un nouveau type, les cas les plus fréquemment cités par les conférenciers étant Airbnb, Blablacar, et bien sûr Uber qui a déclenché des points de vue controversés1. Les éléments qui culminent dans ce phénomène nouveau sont le mode d’échange à distance pair-à-pair (peer-to-peer), et la résolution d’un problème où l’entreprise traditionnelle ne savait pas apporter une solution satisfaisante. Un certain nombre d’autres exemples concrets se sont déjà manifestés ces dernières années, et que j’avais décrit le 13 novembre 2014. J’y mentionnais par exemple des structures comme Ouishare et plusieurs autres innovations fondées sur le « collaboratif » de proximité, et je concluais ainsi : « aucun secteur d’activité ne sera préservé à terme par l’économie du partage et du don. Une vraie réflexion mérite d’être menée sur ce sujet au sein des organisations sur le niveau de maturité des services numériques et de la stratégie d’entreprise qui les porte ».
En effet, la libre circulation doublée d’une maîtrise des données est un facteur de succès pour aligner l’offre sur les besoins réels et désirs latents des clients-consommateurs. En même temps, ces nouveaux modèles d’affaires engendrent, du moins au départ, une forme d’insécurité sociale qui se traduit par des interdits. Cette complexité devant laquelle nous sommes tous placés invite les parties prenantes et concernées à s’adapter aux circonstances et situations, au lieu de s’opposer les uns aux autres, adopter ce que je nomme une « coopérative attitude », et organiser dans le dialogue la transition vers ces nouvelles formes d’économie sociale, solidaire et circulaire.
Pas facile à faire en période de difficultés économiques ! Il est clair que, comme l’expriment Alberto Marchi et Ellora-Julie Parekh (McKinsey§Company)2, les critères à prendre en compte sont la désintermédiation, le partage de la capacité excédentaire et une productivité accrue, ainsi que les défis commerciaux, sur une échelle sans précédent, pour les opérateurs historiques tels que les sociétés de taxis, hôtels, restaurants, et les services publics. Mais il faut également réfléchir sur les bénéfices sociétaux de ces logiques disruptives.
Depuis un an, il y a cependant une subite prise de conscience des dirigeants d’entreprise de l’ampleur du phénomène qu’il recouvre. L’effet communication de l’ubérisation a certainement influé les comportements. Ce phénomène récent est lié au fait que des nouveaux entrants, qui sont en « périphérie » du cœur de métier de l’entreprise traditionnelle d’hier, prennent place sur un marché fragmenté, deviennent leader de leur domaine d’activité, mobilisent les foules3 et tirent des avantages de la myopie et la lenteur des organisations cloisonnées traditionnelles et des spécialités dispersées. Ils offrent directement aux particuliers des biens et des services personnalisés, aussi bien avant, pendant et après le Service alors que le client était habitué à une offre centrée « produit banalisé ».
Quel est le secret de l’ubérisation ?
Leur secret tient dans leur habileté à relier ce qui était jusqu’ici séparé dans un univers taylorisé (par exemple Apple et la révolution du secteur musical depuis Ipod et iTunes il y a quinze ans), le design épuré des interfaces homme-machine, la simplicité et la gratuité d’accès aux données, la commodité d’usage, l’interface conviviale des outils mobiles, la possibilité offerte à chacun d’entre nous de « paraître » (et que certains qualifient à tort « exister ») et d’avoir une réputation chiffrée (comme sur eBay, via les avis partagés). En contrepartie de cette capture de données, ces « prédateurs »4 ciblent de mieux en mieux leurs proies humaines (exemple : Google), atteignent les sommets d’une capitalisation boursière exacerbée et engrangent des centaines de millions de dollar via la publicité, sans « faire mal ».
Ce système fonctionne de mieux en mieux car chacun d’entre nous cède à la tentation de prendre les « manettes »5 de l’action via son PC ou smartphone, court-circuitant ainsi les flux de transactions traditionnels lorsqu’une offre alléchante retient son attention (souvent le critère du prix et le low cost). En se servant ainsi de la technique, chaque usager qui se sert devient en même temps serviteur6 et accepte dans les services numériques une servitude de fait7, souvent à son insu… Ce grand « court-circuitage » (expression utilisée par Yves Citton dans l’émission animée par Frédéric Taddéï8 des flux traditionnels touche(ra) presque tous les secteurs d’activités. Il s’agit d’une lame de fond à prendre au sérieux. Par exemple, lorsque Lending Club assure des prêts entre particuliers sans passer par les banques, ou Task Rabbit qui agit sur le terrain du marché de l’emploi, les règles du jeu d’hier sont totalement changées.
Bien entendu, il y a en coulisse des infrastructures imposantes au niveau hard mais surtout software et architecture des données, des modélisations compliquées qui nécessitent un professionnalisme de haut niveau en mathématiques et en informatique ainsi qu’en intégration des systèmes et d’importants investissements financiers et humains. C’est la partie cachée de l’iceberg dont on parle malheureusement peu. Demain, ce seront des avatars par milliards ainsi que des robots, qui seront les interlocuteurs des êtres humains, sans que ces derniers le sachent, à distance souvent, avec tout ce que l’intelligence artificielle peut apporter pour que le test de Turing entre dans la réalité opérationnelle. Sans oublier que l’ordinateur quantique arrive sur le marché et qui serait « 100 millions de fois plus rapide qu’un ordinateur classique »9…
Quels sont les impacts de l’ubérisation sur le travail et l’emploi ?
Si l’ubérisation ne crée pas d’emploi salarié traditionnel, il génère des « petits boulots » (en bas de l’échelle) ou l’entrepreneuriat (en haut de l’échelle), remet en cause le contrat de travail d’hier, et nous invite à nous interroger sur la grande mutation du travail et de l’emploi10 ainsi que l’émergence de nouveaux modèles d’affaires. Des enquêtes11 ont déjà été menées à ce propos pour savoir s’il s’agit d’une clientèle de jeunes, concernant les taxis, s’il s’agit de courses de nuit ou de jour, en centre-ville ou en périphérie, le temps du trajet, l’objectif poursuivi, l’importance du prix, la place de la confiance , etc. Plusieurs thèses se développent autour de cette logique disruptive en termes d’emploi et de « fin du salariat » et le magazine L’Expansion a consacré son numéro de novembre 2015 à ce thème.
En fin de compte, lorsque nous interrogeons dans le coin à ragots (autour de la machine à café) les managers sur ce sujet, il apparaît une hésitation chargée d’ambivalence sur l’attitude responsable à tenir, les témoignages font part d’intérêts antagonistes qu’il faut savoir négocier au fond de soi-même, ainsi que la sensation qu’un véritable rouleau compresseur est en train d’avancer contre lequel on ne peut rien. Schumpeter et la « destruction/créatrice » nous viennent bien sûr l’esprit. Il faut donc un langage commun et une boite à outils car il y a plusieurs catégories d’individus : ceux qui sont « pour », ceux qui sont « contre », ceux qui sont « prêts à suivre à condition… », ceux qui « n’ont pas d’opinions » et ceux qui disent : « on va dans le mur ! ». Mais quelle stratégie doit-on adopter pour se comprendre et agir ensemble ?
Une Stratégie des Relations doit-elle être mise en place ?
Le phénomène de l’ubérisation fait jurisprudence dans l’histoire de l’économie. On ne pourra pas tout régler par la loi et les interdits. La transition vers de nouvelles formes d’économie sociale, solidaire et circulaire est inévitable. Quel plan de marche faut-il adopter pour adapter nos modèles économiques ? Une Stratégie des Relations doit-elle être mise en place ? Quelle feuille de route pourrait réunir les opinions contraires, quel que soit le secteur d’activité ?
Les évènements de l’été 2015 autour des taxis parisiens et l’application UberPop m’ont donné l’occasion de remettre sur la table de travail une « boite à outils » que j’avais suggérée en 1997 dans mon livre « l’Avantage coopératif ». En novembre dernier, au contact d’un groupe de personnes volontaires, qui ont accepté avec gentillesse de jouer chacun un rôle (chauffeur de taxi, client, syndicat), ce travail de recherche en mode collaboratif a fourni, encore une fois, des résultats très instructifs. Sans entrer ici dans les détails, et en préservant l’anonymat des personnes qui ont accepté de jouer ces rôles, il s’agissait de créer un dialogue constructif entre les parties prenantes et celles concernées d’un « Projet d’ubérisation ». En partant non pas sur le terrain de la rationalité, mais sur celui de la subjectivité, des craintes, des tensions et des conflits potentiels (dimension irrationnelle). Le scientifique devient alors pédagogue et animateur.
Cette boîte à outils est maintenant éprouvée depuis 17 ans au contact de plusieurs centaines de managers. Elle se nomme le CRIC® (comme Craintes et divergences des Cultures, Reconnaissances réciproques, Intérêt général et Conflits). Elle intègre, sur le plan méthodologique, une rencontre entre le déterminisme rationnel et l’empirisme des expériences vécues. Il faut en premier lieu repérer les acteurs concernés, faire un cadrage du terrain de jeu élargi et aux frontières déplacées, tenir compte des structures et des cultures, puis ensuite écouter les opinions contraires, créer des synergies autour de l’Intérêt général, etc. Cette dynamique coopérative, fondée sur une expérience humaine en groupe et une démarche constructiviste, permet de révéler la transformation du comportement des acteurs, chemin faisant, afin d’adapter à chaque situation spécifique des solutions objectives.
La première clé de cette transformation est la dynamique relationnelle de la coopération. Le Lien est la pierre angulaire. La cogouvernance®, à laquelle je crois depuis longtemps, en est le pilier central. Elle ne se limite donc plus au partenariat interne DSI / Métiers/ DG et aux règles normatives, mais intègre également les possibilités d’alliances internes et externes, ce qui n’exclut pas de possibles changements d’orientation comme nous l’apprend l’actualité récente où « la SNCF stoppe son opération controversée avec Airbnb »12.
En conclusion, avec quelques concepts simples, tels que ceux énumérés ci-dessus, associés à un système d’appréciation des modes d’action plausibles, on peut obtenir en très peu de temps des résultats très stimulants qui enthousiasment ceux qui y ont contribué et que les approches traditionnelles de modélisation du changement ne parviennent pas à faire.

Auteur et Conférencier
www.cogouvernance.com
16 décembre 2015
_____________________
1 Uber, vers la fin du mythe collaboratif ?
2 Consulté en décembre 2015
3 Relire la psychologie des foules, de Gustave Bon, Jean-François Phélizon, 2011
4 Prédation et prédateurs, Michel Volle, 2008
5 L’homme simplifié, Jean-Michel Besnier, Fayard, 2012
6 Jacques Ellul, Le Système technicien (NE), 2012,
7 Discours de la servitude volontaire, Etienne de la Boétie
8 Sur France2, le 11 décembre 2015
9 Site consulté le 16-12 2015
10 Le travail : une valeur en voie de disparition, Dominique Méda
11 Site consulté le 16 12 2015
12 Article publié le 15/12/2015, mis à jour le 16/12/2015, consulté le 16 12 2015