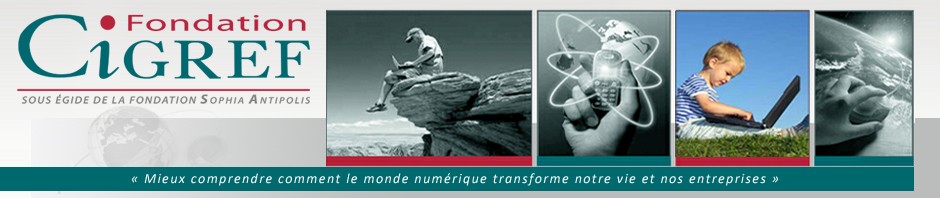L’ossature du Programme international de recherche ISD se fonde sur 5 perspectives analytiques, dans la continuité des recherches en cours au plan européen et des choix du CIGREF. Considérées de manière interactive et systémique, ces perspectives permettront de saisir les forces motrices des futurs possibles des entreprises et de leur SI
En tenant compte des objectifs du programme de recherche international ISD, cinq perspectives analytiques constituent l’ossature de la recherche. Ces cinq thématiques se situent en droite ligne des choix effectués dans le cadre de la démarche prospective du CIGREF. Elles tiennent compte également des thématiques développées par des programmes similaires (MIT sur l’entreprise du XXIème Siècle). Elles se situent en continuité des recherches en cours au plan européen (programme société de l’information et des médias) ainsi que dans le cadre de programmes de recherche de l’OCDE (technologies de l’information) et d’autres institutions internationales (économie de la connaissance du World Bank Institute). Elles considèrent les plans stratégiques formalisés ou en voie de déploiement dans certains pays (U-Japan, pour Ubiquitous Networks par exemple).
Le devenir des entreprises – et le design des futurs de leurs SI – seront déterminés par l’interaction entre évolutions sociétales et éthiques, évolutions stratégiques, technologiques, de régulation, et organisationnelles. C’est en considérant ces cinq perspectives, de manière interactive et systémique, que nous pourrons saisir la réalité des forces motrices des futurs possibles des entreprises et de leurs SI.
– Perspectives sociétales et éthiques, car c’est au sein des sociétés et de leurs évolutions que les normes de comportement – y compris en termes d’innovation et de relation aux TI – se forment.
– Perspectives stratégiques, car les modèles d’affaires d’aujourd’hui vont nécessairement connaître de grandes ruptures, au sein desquels les réseaux, les communautés et le marché spot vont jouer un rôle déterminant.
– Perspectives technologiques, car l’ubiquité des artefacts informationnels va se généraliser.
– Perspectives réglementaires car de nouvelles normes – réglementaires notamment – vont apparaître afin de réguler les transitions qui se dessinent (nous devons donc nous y préparer, et naturellement, les influencer).
– Perspectives organisationnelles enfin, car, les entreprises et les sociétés vont connaître de grandes transformations en matière d’organisation du travail, de standards et de déploiement de processus. Il est essentiel pour nous de bien les identifier et de s’y préparer.

En termes plus opérationnels, plusieurs critères sont à considérer comme structurants de l’ensemble du programme de recherche ISD :
– La recherche est organisée autour d’un concept central : le design organisationnel. Par là, le programme souligne de manière forte combien la problématique du design est un concept permettant de construire des visions stimulantes pour la réflexion et l’action, en particulier dans une perspective à long et moyen termes. Dans son articulation, le programme de recherche ISD considère que tout est design : la société est en design, les organisations sont en design et les individus le sont également, autrement dit en construction ou dé-construction.
Mais le design est proposé comme instrument d’analyse, et non comme concept résultant, fondateur de l’identité du programme. Ce qu’ISD propose, c’est de construire une identité propre à l’histoire des usages des systèmes d’information dans les grandes entreprises et la société françaises et d’évaluer les dé-constructions sociétales, organisationnelles, stratégiques, technologiques, réglementaires et éthiques à venir. Le tout devant faire, in fine, une lecture conceptuelle transversale.
Les objectifs d’ISD visent des cibles dépassant largement la sphère classique de la grande entreprise. Le programme n’est pas centré sur la grande entreprise, mais sur les grandes transformations technologiques, géopolitiques, organisationnelles et sociétales, susceptibles d’influencer les modes d’articulation des activités ainsi que le rôle clé des technologies et systèmes d’information, en tant que médiateurs de réalisation des activités sur le temps long (1970-2020).
![]()